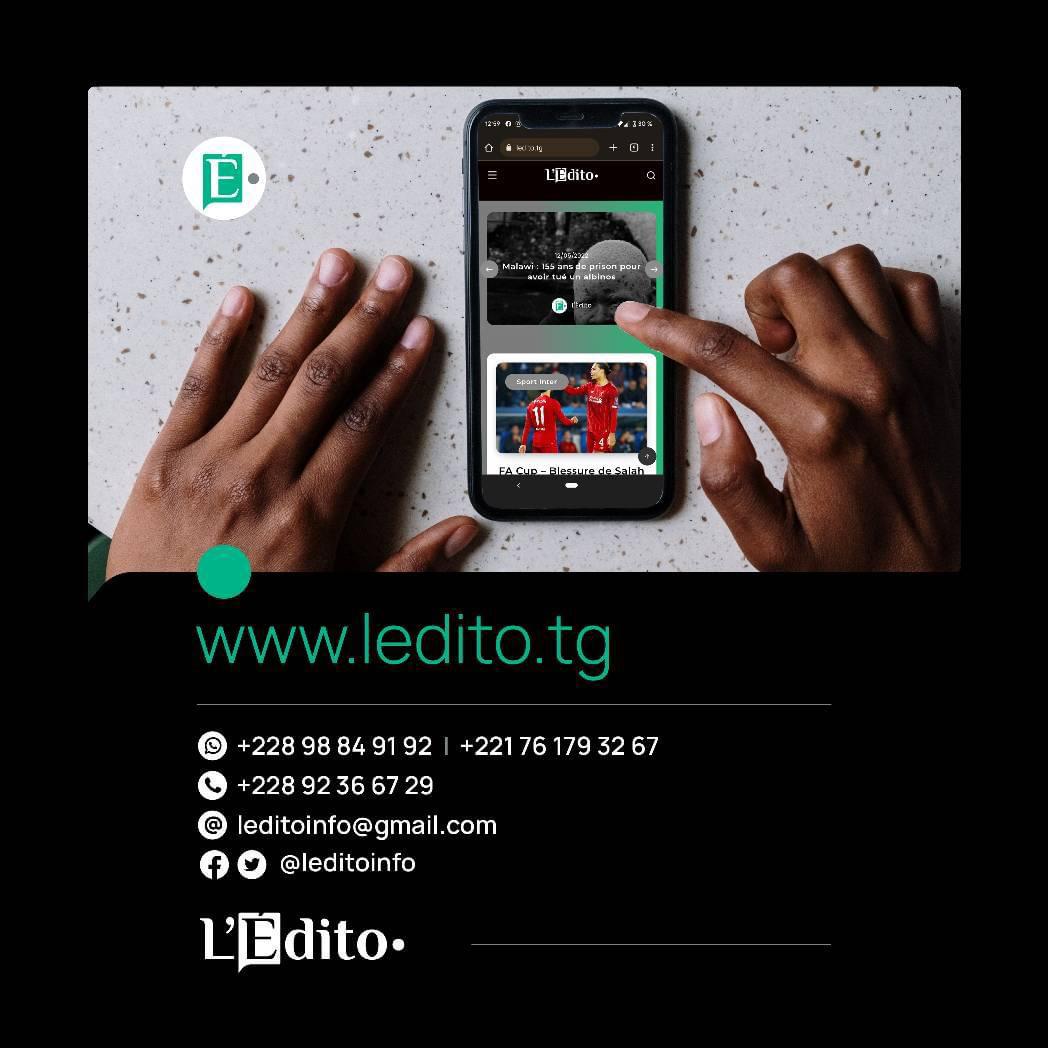Lancée un 28 mai de l’année 1975, la Cedeao s’apprête à célébrer son cinquantenaire. Ce point d’âge symbolique à tout organe marque ainsi l’occasion de peser les points positifs et négatifs de l’organisation communautaire. Cependant, il est assez visible que dans l’air du temps, la Cedeao apparaît aujourd’hui plus que jamais comme une institution rongée par l’incertitude.
Entre crises communautaires et procès d’illégitimité ou encore accusation de soumission internationale, la Cedeao renvoie l’image d’une organisation écartelée, bercée dans ses propres contradictions.
Contexte et évolution
Partant d’une idée de base, et d’une vision unificatrice, la Cedeao a dans un premier élan réussi à faire asseoir autour d’une même table, anglophone , lusophone et francophone de la même région. Rompant ainsi, avec l’épineuse question de la barrière linguistique formelle.
Cette réussite (d’union de francophones , de lusophones et anglophones) a fait naître une réalité fonctionnelle qui a conféré à l’organisation une puissance diplomatique et une forme de souveraineté communautaire. Dans cet ordre d’idée, le siège de la Cedeao se trouve à Abuja au Nigéria ; d’autre part à ce jour et selon plusieurs instituts d’analyses et d’expertises, “ la Cedeao est aujourd’hui la région:communauté, la mieux intégrée en Afrique.
En effet, selon la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), « la Cedeao est la seule région en Afrique où il n’existe pas de visa entre les Etats depuis 1980 », et ce même bien avant l’entrée en vigueur de l’Accord de Schengen de l’UE en 2005.
Un état d’intégration facile et accessible aux citoyens membres de la Cedeao qui confère à l’organisation d’être un exemple réel de réussite communautaire.
Cependant, à la réalité politique et sociale d’intégration se heurtent celui de l’équilibre et des échanges commerciaux et économiques. L’union économique et monétaire étant l’une des ambitions principales de la création de la Cedeao, elle est restée le sujet le plus inabouti de l’Espace en son demi-siècle d’existence.
Tenue par des convictions nationalistes de souveraineté d’une part et par la volonté de l’équilibre monétaire communautaire d’autre part, la question bancaire/monétaire est demeurée pendant longtemps presque tabou.
Selon les données officielles de la CEA, le commerce intra-régional est «d’une ampleur relativement limitée» dans l’espace CEDEAO. Il représente environ 9,0% du total des exportations des pays membres et 10,5% du total des importations. Une situation peu reluisante après 50 ans d’opération. Dans la même dynamique, on relève que le commerce intra régional reste faible, avec des échanges intra-CEDEAO inférieurs à 12 %.
En termes comparatifs , l’Union Européenne atteint pour le même indice un pourcentage de près de 60% (malgré le Brexit).
Cedeao, crise de confiance et rupture populaire
A tout ce déficit économique et monétaire se sont ajoutés, les crises politiques nationales et le regain d’un certain souverainisme africain subsaharien, dûs à la montée d’un néo-panafricanisme dont les contenants sont difficiles à définir.
Une crise de confiance des peuples même en l’institution qui a perdu de sa crédibilité du fait d’être souvent alignée politiquement avec l’Union Européenne et par là même l’Union Africaine.
Ce rejet profond des populations s’est traduit politiquement dans le Sahel par la montée au pouvoir des militaires, qui , renversant l’ordre constitutionnel, apparaissent aux yeux des populations en quête de changement et de nouveau paradigme comme la panacée.
L’étape ultime de l’affaiblissement a été consacrée par la crise politique au Niger, où la Cedeao avait promis le retour à l’ordre constitutionnel par la libération du président Bazoum qui jusque-là reste toujours prisonnier.
Un manque de constance, une direction pas toujours claire et le sentiment par les populations d’un abandon total restent les principaux ingrédients, qui selon plusieurs experts, expliquent les incertitudes et le pouvoir entamé de la Cedeao aujourd’hui.
En rappel, selon le FMI, le PIB/PPA global des États membres de la CEDEAO s’élève à quelque 564,86 milliards de dollars ce qui en fait la 25ème puissance économique mondiale.
A ce jour, sur le plan commerciale, elle ne dispose pas de compagnies pharmaceutiques de références, d’industrie agro-alimentaire ou encore d’organe communautaire de censure coercitif.
Michel Glory Samuel TAKPAH, Journaliste togolais